0 Items - 0.00CHF
- Aucun produit dans le panier.
Henri Martin a su exalter en moi l’amour des plantes et de la nature. Sa fréquentation et celle de Thérèse m’ont également donné l’idée d’entreprendre un jardin. Un potager, modeste certes, mais qui doit parvenir à me nourrir du moins partiellement de ses légumes.
Au printemps 1970, je prends donc la bêche pour retourner un lopin de terre dans la résidence secondaire de mes parents, à Pussay, où j’ai passé une belle partie de mon enfance. Mais la réalisation de ce projet s’avère rapidement moins facile que prévu. Parmi les épinards et les laitues pousse spontanément quantité de plantes, d’abord à peine visibles puis d’une ampleur vite inquiétante, allant bientôt jusqu’à égaler puis dépasser les légumes que j’ai semés. Horreur, des « mauvaises herbes » ! Ma première pensée est bien sûr de les arracher. Mais à la réflexion, il serait intéressant de savoir au moins qui elles sont et si elles pourraient présenter quelque intérêt.
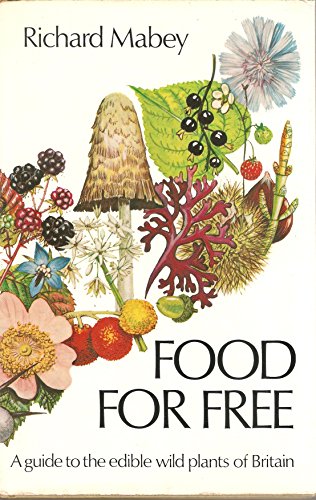
Les identifier n’est pas trop compliqué, mais parvenir à déterminer leur utilité se révèle nettement moins aisé. Les livres sur les plantes sauvages comestibles sont alors pratiquement inexistants en langue française. Je possède en revanche un ouvrage anglais, Food for free de Richard Mabey, acheté fortuitement lors de l’un de mes séjours dans la capitale britannique. Je m’y plonge et apprends avec surprise que le chénopode blanc, d’ailleurs cousin des épinards, est un excellent légume, déjà consommé par l’homme au Néolithique, que la stellaire, avec sa tendre texture et sa délicate saveur de noisette, forme l’une des meilleures salades qui soient, et que le laiteron, cet espèce de pissenlit monté sur une longue tige donne des pousses délicieuses. Il vaut donc bien la peine de sacrifier pour cela un peu de mes épinards et de ma laitue.
Avec toutes les plantes qui s’y complaisent, l’aspect apparemment négligé de mon potager n’est guère convenable. Mais mes explorations portent leurs fruits car il m’apparaît que nombre de ces herbes habituellement indésirables ne sont autres que de très anciens légumes, maintenant oubliés, qui ont nourri nos ancêtres pendant des millénaires. Je n’hésite donc pas à en faire mon profit, en complément des produits classiques de la culture.
Ainsi grandit ma passion pour la cueillette des plantes sauvages. De nombreux essais me permettent de découvrir des sensations inédites. L’idée de trouver sa nourriture dans la nature semble pleine d’intérêt car ce pourrait être un moyen efficace de se libérer de l’emprise d’une société de consommation qui nous étouffe. L’analyse de mes vrais besoins me fait apparaître superflu le confort dans lequel nous vivons. S’il ne fait pas trop froid, je peux vivre dehors et il n’est pas trop difficile de trouver de l’air pour respirer et de l’eau pour me désaltérer. Reste le besoin fondamental de me nourrir : s’il peut être satisfait sans bourse délier, me voici autonome. Avec un minimum de connaissances, les plantes vont me le permettre. Et lorsque j’apprends en lisant un ouvrage d’ethnologie que les chasseurs-cueilleurs[1] ne travaillent en général que trois heures par jour pour subvenir à leurs besoins, mon fond de paresse intrinsèque s’en trouve conforté.
Reste à m’y mettre. Le bagage botanique que j’ai acquis dans mon enfance m’est d’une aide inestimable et Henri Martin m’a déjà enseigné bon nombre de végétaux, mais un sérieux travail reste à faire. Témoin la mésaventure qui m’arrive avec mon amie Danièle.
Le livre Food for free vante les délices des beignets de fleurs d’acacia, nom populaire du robinier, un grand arbre aux rameaux épineux qui porte des feuilles divisées en deux rangs de folioles arrondies et de longues grappes de fleurs blanches délicieusement suaves, en forme de fleurs de pois. Il me semble bien le connaître car un énorme individu à l’écorce profondément crevassée poussait dans le jardin de mes parents à Angoulême. À l’époque je suis un fan de friture, et nous nous délectons d’une quantité peut-être un peu déraisonnable de beignets parfumés. Mais une heure environ après le repas, je me sens lourd et le visage de Danièle devient livide : deux minutes plus tard, elle est penchée sur les toilettes et vomit le contenu de son repas. Moi, ça ne va vraiment pas. Mon front perle de sueur, ma respiration se précipite et je dois m’allonger. Il ne me reste plus qu’à suivre bientôt le même chemin que mon amie – et immédiatement, tout va mieux.

Le soir, la faim est de retour et je suis prêt à terminer le plat de beignets (froids) que nous n’avions pas fini à midi. Déception, Danièle m’avoue les avoir jetés car elle pense qu’ils ont pu être à l’origine de notre malaise… L’idée ne m’en avait même pas effleuré. Dans les jours qui suivent, en creusant la question, je me souviens qu’il existe un arbuste[2] voisin du robinier, le cytise, qui lui ressemble superficiellement, à quelques différences près : il n’a pas d’épines, ses feuilles sont composées de trois folioles seulement, comme celles du trèfle, et ses fleurs sont jaunes… et violemment toxiques. Nous retournons sur les lieux de la cueillette, pour constater que poussent là une rangée de superbes cytises à la floraison d’or ! Merci Danièle, une seconde intoxication aurait pu se montrer fatale…
Cette expérience m’incite à une humilité certaine devant les possibilités de confusions : la cueillette est une activité à ne pas prendre à la légère. Il importe d’être absolument sûr de ce que l’on ramasse, et donc d’être capable d’identifier les plantes avec la plus grande précision.
Munis d’un guide de détermination détaillé, Danièle et moi décidons de partir explorer les Alpes du sud, probablement la région la plus sauvage de France. L’étude de toutes les cartes Michelin du Midi pour y repérer les zones qui comportent le plus de blanc, c’est-à-dire le moins de villages et de routes, les secteurs les moins habités, fait porter notre choix sur la N° 81 : direction les Basses-Alpes !
Après deux jours d’un voyage pittoresque, nous remontons le cours de l’Asse à travers une succession de gorges étroites et d’amples vallées. Passé le village semi-abandonné de Blieux, la route goudronnée se termine brusquement au pied d’un champ de lavande en fleurs. Voici le but de notre périple. Je promène autour de moi un regard ébahi : ce paysage est différent de tout. Un univers de montagnes sèches, couvertes ça et là de chênes et de pins, ailleurs d’une brousse de genêts et de buis, souvent d’une maigre pelouse que l’érosion a décapée par endroits. Abruptes et torturées, creusées par la violence des orages, elles se voudraient sévères. Mais l’austérité du décor est tempérée par un ciel d’une pureté parfaite auquel répondent les touches violet tendre de la lavande. La fraîcheur de l’air, malgré l’ardeur du soleil, ajoute à la sensation de bien-être qui m’envahit au sortir de la voiture. Une fois le contact coupé, le silence s’instaure, rempli du gargouillis du torrent et du bruissement de la brise dans les feuilles. Les plantes, les roches et la terre semblent vibrer, comme animées d’une vie palpable. Et quelle odeur, à la fois douce et revigorante, comme je n’ai jamais encore eu l’occasion de sentir ! Nous respirons à pleins poumons ce mélange subtil de végétal et de minéral, changeant avec le vent dans un vaste registre d’harmonies raffinées qui emplit le corps de bonheur et ravit le cœur.

De l’autre côté du cours d’eau s’étend un pré accueillant, presque plat, où nous pourrions monter notre tente. En y arrivant, nous apercevons, blottie au pied de la colline, une maison qui ne paraît guère habitable. Pourtant une forme noire en sort. C’est une femme âgée, un châle sur les épaules, un fichu sombre sur la tête. Nous nous dirigeons vers elle pour lui demander l’autorisation de camper ici. Elle ne se rend compte de notre présence que lorsque nous sommes arrivés à quelques mètres d’elle. Ses yeux tombent sur nous. Plus que de la surprise, ils reflètent un véritable effroi. Levant les bras, elle fait demi-tour et se précipite en criant dans son patois provençal vers la maison où elle s’engouffre. La porte claque. Nous restons interdits et nous dévisageons : qu’avons-nous donc de si terrifiant ?
La porte s’ouvre à nouveau. Une tête paraît, suivi du corps d’un homme. Un berger aux cheveux blancs, vêtu de grosse toile bleue et coiffé d’un béret. A la main, il tient un bâton tortueux, poli par l’usage. Son visage traduit la méfiance puis, nous ayant observé, il se détend. Avant qu’il n’ait parlé, je lui expose notre requête en nous présentant. Il s’approche de nous, sourit et d’une voix chantante nous exprime son accord. Puis il appelle sa femme :
– « Zéphirine, viens-donc ici. Ce sont deux jeunes parisiens qui viennent de là-bas, ce ne sont pas des martiens. »
Et se tournant vers nous :
– « Vous savez, elle n’a pas l’habitude de voir des étrangers d’ailleurs. Ici, personne ne vient jamais, sauf parfois quelques Marseillais. »
À 75 ans, Zéphirine n’est jamais sortie de sa vallée, si ce n’est que, très occasionnellement, pour se rendre à Barrême, le chef-lieu de canton, à une vingtaine de kilomètres. Robert, son mari, est monté dans le nord, bien malgré lui : en 1914, à vingt-et-un ans, appelé à faire la guerre sur le front de l’est pendant quatre années terribles. Presque tous ses camarades sont morts, il est l’un des seuls revenus au pays – les listes de noms sur les monuments aux morts de la région sont d’une longueur effrayante. Il est berger ici. Quelques moutons pour payer le sucre et le café, le tabac et les impôts, un potager pour se nourrir, un carré d’épeautre pour la soupe, un autre de blé pour le pain, c’est tout ce dont Robert et Zéphirine ont besoin pour vivre et être heureux.

Découvrez notre formation en ligne conçue par François Couplan, expert en ethnobotanique internationalement reconnu avec plus de 50 ans d’expérience. Avec 30 modules, 120 cours et un enseignement théorique de qualité complété par des cours sur le terrain, cette formation unique au monde, sur trois ans, vous permettra de devenir un professionnel des utilisations des plantes. Accessible à tous, elle explore en profondeur les relations entre l’homme et les plantes, ouvrant ainsi des opportunités professionnelles passionnantes. Rejoignez-nous pour approfondir vos connaissances, explorer le monde végétal et développer une relation enrichissante avec la nature.

Danièle et moi passons auprès d’eux quatre semaines inoubliables à parcourir les montagnes embaumées de lavande sauvage. Après la séance de yoga quotidienne, nous nous baignons chaque matin dans le torrent glacé puis nous séchons nos corps à la chaleur du soleil qui passe brusquement la crête. Nous grimpons sur des sommets d’où la vue s’envole, de monts en vallées, vers l’Italie, le sillon du Rhône, le Ventoux et l’Oisans. Nous redescendons à travers des gorges inquiétantes, encombrées de rochers qu’il nous faut escalader au risque de rester coincés ou de nous casser une jambe.
Je m’adonne avec ardeur à ma passion pour la botanique. C’est là que je tombe amoureux fou de la lavande sauvage qui essaime à travers les montagnes ses touffes de feuilles grisâtres surmontées de tiges minces et rigides que terminent d’élégants épis d’une tendre couleur, un violet raffiné teinté de bleu. Tellement plus fine que celle que l’on cultive ou – bien pire – que l’affreux lavandin aux relents de camphre, la lavande vraie, ou « lavande à feuilles étroites », est une plante gracieuse dont la fleur froissée entre les doigts me met dans un état proche de l’extase. Ce n’est pas qu’aux sens que s’adresse son parfum exquis : il sait émouvoir l’âme, qu’il élève. Un avant-goût du Paradis !

Les Labiées[3] aromatiques abondent sur ces pentes calcaires où l’humidité fait défaut. Quatre d’entre elles me frappent plus particulièrement. Le thym aux senteurs nuancées, parfois citronnées ou plus âcres. La sarriette, le pebre d’aï (poivre d’âne) des provençaux, un buisson raccourci densément couvert de feuilles d’un vert foncé, raides et aiguës, qui brûlent la bouche lorsqu’on les mâche, douées de remarquables vertus digestives. La germandrée petit chêne aux feuilles lobées, copies miniatures de l’arbre, et la germandrée luisante à l’aspect verni. Toutes deux portent de jolies fleurs roses et dégagent au froissement une odeur qui rappelle le fromage de chèvre. Leur terrible amertume leur confère des vertus tonifiantes.
Les rencontres végétales se succèdent mais il nous faut malheureusement quitter un jour ce pays béni, non sans promettre à nos nouvelles connaissances d’y revenir. Ce séjour dans la liberté et la beauté nous a permis de découvrir bien davantage qu’une région.
[1] On devrait plutôt dire « cueilleurs-chasseurs » car l’alimentation végétale est généralement plus importante que l’animale.
[2] Un arbuste est un végétal ligneux à tronc unique, de moins de 6 m de hauteur.
[3] Plantes de la famille de la menthe, de la lavande, du thym et du romarin, caractérisées par une tige carrée, des feuilles opposées et des fleurs à deux lèvres distinctes. De nombreuses espèces sont aromatiques et utilisées comme condiments.
