0 Items - 0.00CHF
- Aucun produit dans le panier.
Avant de partir aux États-Unis, j’avais appris l’existence d’une bourse destinée à encourager les jeunes gens désireux de concrétiser un rêve, une passion. J’avais donc déposé un dossier auprès de la Fondation de la Vocation. Mon désir était d’apprendre d’abord puis d’enseigner les usages des plantes sous forme de cours et de publications : il m’a toujours paru essentiel de réconcilier l’homme avec la nature. À vingt-quatre ans, je ne savais pas vraiment comment m’y prendre mais il me semblait être sur la bonne voie.

La sélection des candidats avait lieu l’année suivante, pendant que les vastes espaces américains accueillaient mon enthousiasme. La bourse en question était bien loin de mes pensées et ce fut une surprise de recevoir parmi mon courrier tardif, une lettre m’annonçant l’acceptation de ma candidature et ma convocation à un entretien. Évidemment, mes escapades dans les bois et les nombreux festivals qui occupaient alors ma vie m’empêchèrent de m’y rendre. Il se trouve cependant que mon dossier avait retenu l’attention de l’un des membres du jury, un jeune paléoanthropologue qui venait de connaître la gloire par la découverte de la plus célèbre des australopithèques, Lucy. Yves Coppens me faisait savoir qu’il serait heureux de me rencontrer.
Nous faisons connaissance en 1975, au cours d’un de mes rares séjours en France. L’entrevue est plus que cordiale. Yves Coppens m’exprime son intérêt pour mes « recherches » sur la consommation des plantes sauvages. Les archéologues commencent à se rendre compte que nos ancêtres ne pouvaient pas se nourrir exclusivement de mammouths et d’ours des cavernes. Ils devaient pourtant manger aussi des végétaux. Certains parlent de noisettes, de mûres ou de fraises des bois, mais la variété de plantes dont disposaient nos ancêtres devait être autrement plus importante que ce que l’on peut supposer ainsi a priori. C’est du moins ce que pressent Yves Coppens : à moi de le prouver !
Cette première reconnaissance marque un tournant décisif dans ma vie. Alors que dans mon milieu familial ou même chez mes amis, l’incompréhension n’est pas loin d’être totale, voici un scientifique de notoriété internationale qui affirme à un jeune homme hésitant de vingt-cinq ans que sa passion s’avère d’un grand intérêt pour le monde de la science.
Le contact avec les plantes représente un besoin profond, aussi vital pour moi que respirer ou aimer. Du jour où il s’est révélé dans toute sa force, je n’ai pu que le laisser exister. L’exploration de la nature renvoie sans cesse à notre personnalité profonde. Il ne s’agit que d’une différence d’angle de vue. Au plus près des éléments, nous nous retrouvons seuls face à nous-même. C’est le lieu idéal pour s’observer, sans concession, sans recours aux artifices inventés par notre civilisation pour échapper à soi-même… Si l’on sait l’écouter, notre être intérieur résonne en harmonie avec notre environnement, les plantes mais aussi les minéraux, les quelques animaux qu’il est possible d’apercevoir, les nuages, l’air qui nous caresse, la pluie…
Lors d’une nouvelle rencontre, en 1980, Yves Coppens m’exprime clairement sa position :
– « Je sais que vous êtes réfractaire aux diplômes. Ce ne sont pour vous que des bouts de papier sans importance, mais dites-vous que cela pourrait quand même vous être utile, on ne sait jamais. Et puis, sans doute rencontreriez-vous des personnes qui vous apporteraient des informations utiles à votre travail. »
Il me précise en outre qu’il ne me sera pas nécessaire de suivre depuis le début les cours de l’Université. Il existe une formation parallèle, fort ancienne et universellement reconnue, l’École pratique des hautes études, qui décerne un diplôme équivalent à la maîtrise sur la base d’un mémoire et de sa soutenance devant un jury. Puisque j’ai déjà rédigé un manuscrit de quelque huit cents pages, cela ne devrait pas poser de problème.
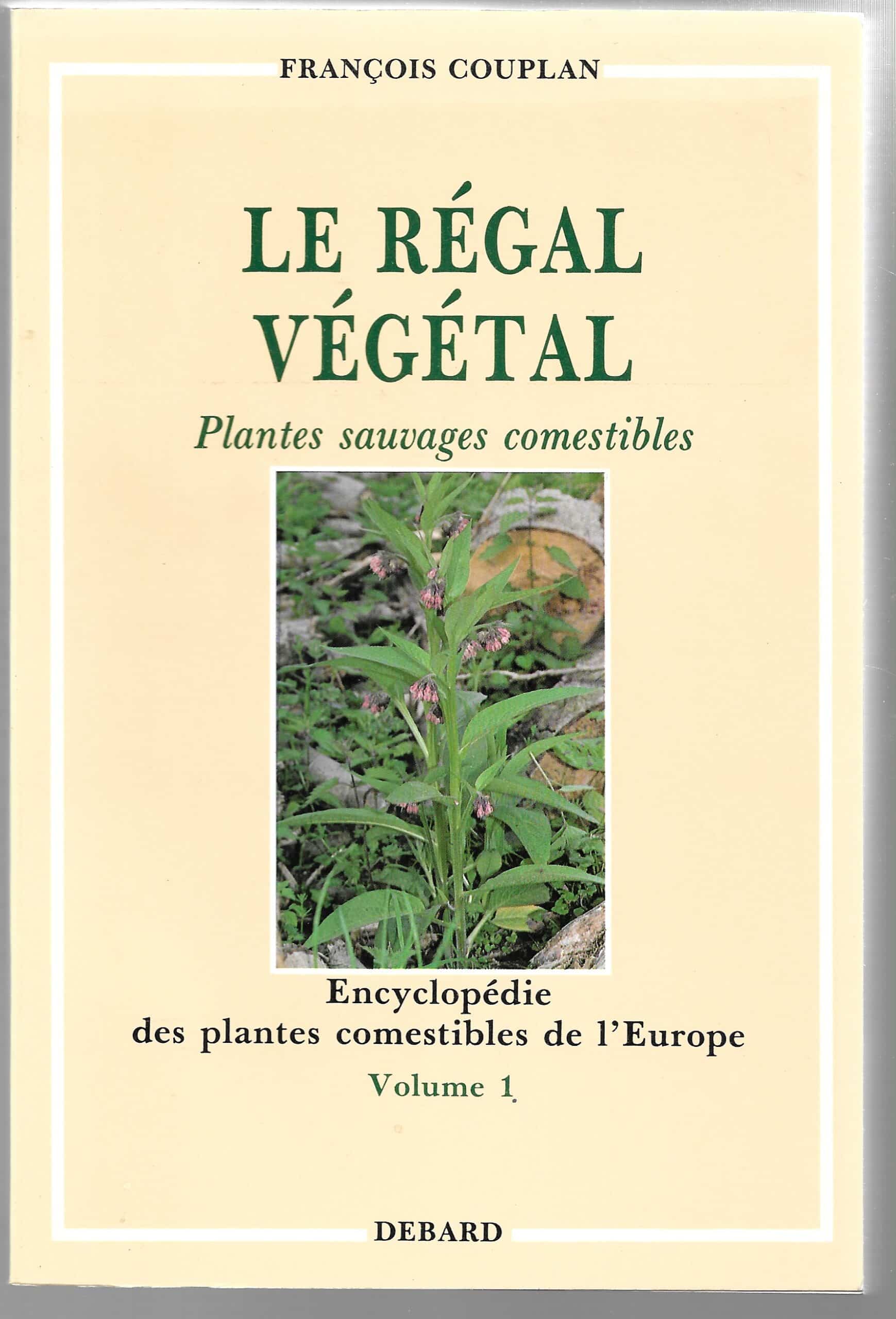
La personne qui va me guider dans mon travail est le directeur du laboratoire de botanique au Muséum national d’histoire naturelle, Jean-François Leroy. Il est taxonomiste, c’est-à-dire qu’il étudie la classification des végétaux, mais il a également travaillé comme ethnobotaniste et possède un diplôme de philosophie. La largesse de sa pensée me séduit. Il n’est pas de ces spécialistes dont la vision du monde s’arrête aux murs intérieurs de leur tour d’ivoire. Il est d’un autre temps : peut-être la science est-elle devenue trop pointue de nos jours pour que ceux qui en font profession puissent embrasser du regard l’ensemble de la vie plutôt que de se cantonner au sujet restreint de leur étude. Pourtant, l’être humain a la possibilité – et peut-être le devoir – de prendre du recul par rapport à ses activités, à ses raisonnements, à sa manière de vivre afin de se situer dans l’univers. La science permet de mieux comprendre les phénomènes de la vie. Nous devons cependant accepter la part du mystère. Le véritable scientifique sait faire preuve d’humilité en admettant les limites de ses investigations et de sensibilité en restant ouvert aux émotions, à la poésie, sources d’inspiration au-delà du rationnel. Jean-François Leroy est de ceux-là. En novembre 1982, je suis prêt grâce à lui à présenter mon travail sur Les plantes sauvages comestibles de l’Europe. D’après les nombreuses questions qu’ils me posent, les membres du jury[1] semblent intéressés par ce que j’ai à leur raconter. Ils apprécient particulièrement qu’il s’agisse de mes expériences, de mon vécu, mis en forme de façon méthodique plutôt que d’une compilation d’ouvrages divers aux affirmations parfois sujettes à caution. Au-delà des livres, j’ai toujours eu à cœur de vérifier par moi-même les indications des auteurs – souvent pour la seule excitation de l’expérience et du partage. Sitôt mon diplôme obtenu, un éditeur me propose de publier mon texte sous forme d’une Encyclopédie des plantes comestibles de l’Europe, en trois volumes, qui paraît en 1984. Encouragé, je contacte d’autres maisons d’édition et me retrouve rapidement avec une dizaine de contrats à honorer dans les années à venir, tous sur les utilisations des plantes, sous divers angles. Apparemment, le sujet est porteur !

Découvrez notre formation en ligne conçue par François Couplan, expert en ethnobotanique internationalement reconnu avec plus de 50 ans d’expérience. Avec 30 modules, 120 cours et un enseignement théorique de qualité complété par des cours sur le terrain, cette formation unique au monde, sur trois ans, vous permettra de devenir un professionnel des utilisations des plantes. Accessible à tous, elle explore en profondeur les relations entre l’homme et les plantes, ouvrant ainsi des opportunités professionnelles passionnantes. Rejoignez-nous pour approfondir vos connaissances, explorer le monde végétal et développer une relation enrichissante avec la nature.
Yves Coppens m’encourage à persévérer dans la voie des diplômes. Il me propose d’extrapoler mes connaissances en matière de plantes sauvages à nos ancêtres paléolithiques. L’idée est séduisante, mais les pistes bien minces puisque l’on ne dispose d’aucun élément concret, les végétaux ne se fossilisant généralement pas.
Me vient alors l’idée d’essayer de reconstruire les environnements dans lesquels vivait l’homme du passé puis d’y rechercher les végétaux qu’il pouvait avoir à sa disposition. Il me sera évidemment impossible de prouver s’il les a effectivement consommés, mais cette approche devrait me permettre de pourrai fournir quelques pistes aux archéologues.

Yves Coppens se montre enthousiaste pour mon projet et m’indique la marche à suivre : contacter de sa part son collègue Henry de Lumley, directeur de l’Institut de paléontologie humaine (IPH) au sein du Muséum. Courant 1991, je rencontre donc ce scientifique célèbre qui – fourches caudines bien légères… – commence par embarquer la collection complète de ma dizaine d’oeuvres alors publiées. Puis je dois obtenir l’équivalence de mon diplôme de l’École Pratique des Hautes Études avec un DEA[2] indispensable pour la préparation du doctorat. Ces formalités accomplies, j’entre dans le laboratoire de palynologie[3] de l’Institut, dirigé par Josette Renault-Miskovsky qui sera ma directrice de thèse.
Pour reconstituer les paléoenvironnements, mon idée est de partir des données fournies par l’étude des pollens dans des habitats préhistoriques sélectionnés. Mon principe est assez simple. Les pollens retrouvés dans les grottes se sont déposés en couches à des époques déterminées. Le relevé de ces pollens constitue la base de mon travail : les plantes qu’ils représentent faisaient partie de l’environnement de l’homme dont les vestiges ont été retrouvés sur le site. Je peux même aller plus loin dans la reconstitution du paysage végétal. En regroupant de façon cohérente les différentes espèces selon les données de la phytosociologie[4], je parviens à établir des associations végétales[5]. Réciproquement, celles-ci permettent d’ajouter à mon inventaire les espèces caractéristiques et compagnes absentes des relevés palynologiques. Je répertorie ainsi la majeure partie des plantes environnant l’homme en un moment et un lieu particuliers. Il ne me reste plus qu’à y recenser les végétaux comestibles et à en discuter la consommation possible, crue ou cuite. En effet, on ne trouve nulle trace de feu antérieure à 500 000 ans, tandis qu’après cette date, pratiquement tous les sites habités par l’homme contiennent des vestiges de foyer. On peut donc supposer qu’auparavant nos ancêtres ne possédaient pas le moyen de faire cuire leurs aliments et devaient consommer les végétaux crus. Ceci pose question car des aliments de base, riches en amidons[6] ou en fibres, ne peuvent être bien digérés qu’après cuisson, d’où la nécessité d’une discussion nutritionnelle.

Pour commencer, il me faut choisir les sites : cinq grottes en région méditerranéenne, dans lesquelles Josette Renault-Miskovski a étudié la présence de pollens. Ils recouvrent ensemble la plus grande partie du Paléolithique inférieur et moyen[7]. Il s’agit, dans l’ordre chronologique, de la grotte du Vallonnet à Roquebrune-Cap Martin, de la Caune de l’Arago près de Tautavel, de Terra Amata et de la grotte du Lazaret à Nice, et de la grotte de L’Hortus près de Valflaunès. Sur les deux premiers sites, aucune trace de feu n’a été relevée, ce qui fait supposer que cet élément n’avait pas encore été domestiqué. Les trois autres sont postérieurs à la domestication du feu, puisque de nombreux foyers y ont été mis en évidence. Ces sites ont été particulièrement bien étudiés du point de vue palynologique. Ils sont situés dans des régions où, des bords de mer aux sommets, les importantes variations d’altitude déterminent un grand nombre d’environnements remarquablement riches en espèces. Les Alpes-Maritimes et les Pyrénées-Orientales sont à l’heure actuelle les deux départements dont la flore est la plus diversifiée. De plus, pendant les glaciations, des zones-refuges à proximité de ces sites ont favorisé la survie de nombreuses espèces. À partir des relevés palynologiques existants, je sélectionne les couches archéologiques comportant le plus grand nombre d’espèces afin de favoriser la discussion phytosociologique et d’accroître l’effectif des plantes consommables. Dans des tableaux, je classe les plantes par ordre décroissant de fréquence, d’après le pourcentage des grains de pollen et mets en évidence les types de végétation qu’elles indiquent, sur la base de leurs exigences écologiques actuelles. Par regroupements, j’arrive fréquemment à déduire des associations végétales bien caractérisées.

Quelques constatations sont étonnantes. Même aux périodes les plus froides de tout le quaternaire[8], la végétation méditerranéenne est constamment représentée, sous trace de pollens de chêne vert, de pins, de pistachier, d’oléastre ou de filaire. Il semble que ces plantes aient trouvé quelque refuge à chaque dégradation climatique, pour se développer de nouveau dès que les conditions le permettaient. Il est également surprenant de rencontrer des plantes rudérales[9] dans les relevés. Ces « mauvaises herbes », compagnes habituelles des cultures de l’homme, poussent dans les lieux riches en azote. Comment pouvaient-elles être présentes plusieurs centaines de milliers d’années avant les débuts de l’agriculture ? Deux explications sont plausibles. Les grands herbivores, mammouths, aurochs et bisons, vivaient en importants troupeaux et se regroupaient dans des reposoirs qu’ils fumaient continuellement de leurs déjections. Il est également concevable que ces plantes aient poussé à proximité des habitats humains, là où les hommes du Paléolithique jetaient régulièrement les déchets des animaux dépecés et les rebuts de leur cuisine.
[1] Composé par le Professeur Leroy, Yves Coppens, Jacques Barrau, directeur du laboratoire d’ethnobotanique du Muséum, une botaniste et un pharmacologue.
[2] Diplôme d’études approfondies.
[3] La palynologie est l’étude des pollens.
[4] La phytosociologie est la science qui étudie les relations des plantes entre elles.
[5] L’association est l’unité de base de la phytosociologie, qui comportent des plantes caractéristiques et des plantes compagnes, habituellement présentes dans un groupement déterminé.
[6] Tels les glands et d’autres graines farineuses.
[7] D’environ 900.000 à 35.000 ans avant notre ère.
[8] Le quaternaire a commencé voici environ 1,6 millions d’années. Lors des périodes glaciaires, le froid envahissait l’ensemble de l’Europe qui se transformait en steppe parsemée de bouquets d’arbres, tandis que pendant certains interglaciaires, la température pouvait être nettement plus élevée qu’elle ne l’est de nos jours.
[9] Du latin rudus, ruderis, décombre.
